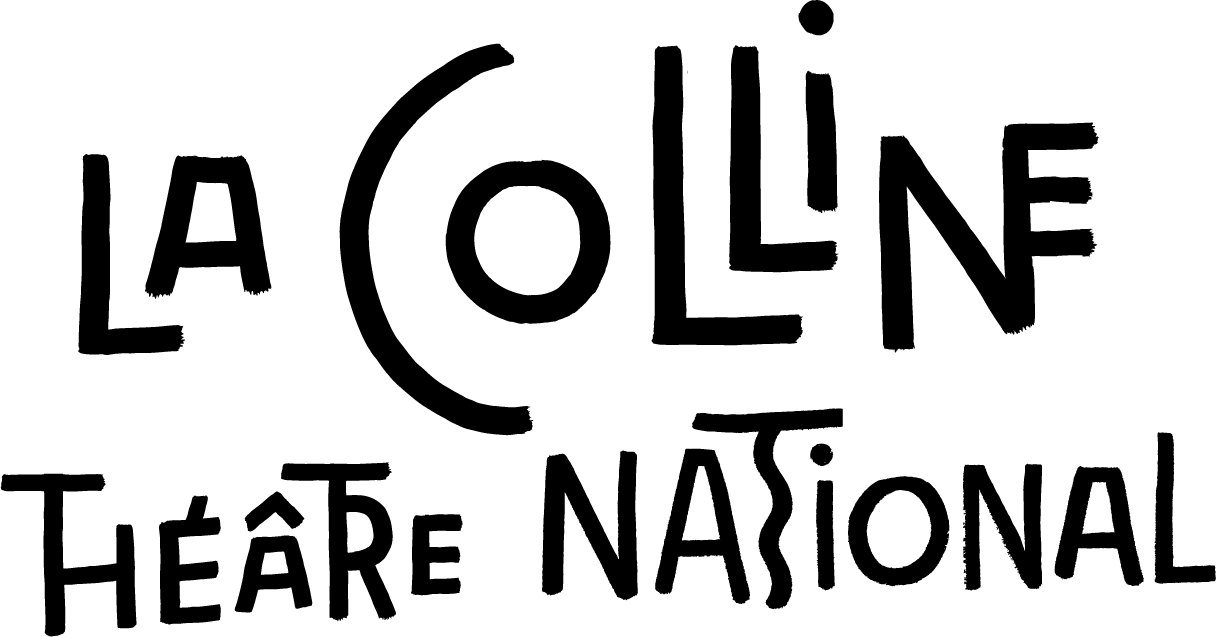L’horizon perd de son tranchant. L’humeur du monde le brouille et sa ligne se détrempe. Heureux celui qui, hermétique à cette mélancolie collective, ne voit pas ses espaces intérieurs déteindre les uns sur les autres et parvient encore à savoir où il en est. Les paysages s’érodent les uns après les autres, une humidité à gros grain écrase tout, sans structure véritablement, nous regardons comme à travers un papier buvard, les taches d’un monde qui n’est plus et auquel on continue à s’accrocher. Le dessin que dilue la bavure ne retrouve jamais sa forme initiale.
- Qu’as-tu ? demande l’ami attentionné.
- Je ne sais pas.
Et comment répondre quand on parvient à peine à différencier les arbres d’avec leurs ombres, les visages d’avec leurs reflets et les mots d’avec les mots ? On sort de chez soi. On traverse rues et boulevards avec le sentiment de vivre à l’inverse. Mais l’inverse de quoi ne cesse-t-on de nous demander ? Et dans ce quotidien qui boite, chacun fait comme il peut et porte sa vie à bout de bras. Elle semble à la fois si dérisoire et si précieuse. On fait ce que l’on a à faire même si le sens nous est renvoyé à la figure. La marge de nos vies, marge à travers laquelle et grâce à laquelle on parvenait à s’extraire des vicissitudes de l’existence, cette marge-là est plus que jamais à la marge. Sans plus de raison d’être que de continuer à être, être devient une injonction anatomique : rester en vie. Redevenir animal reproducteur mangeant déféquant.
Pourtant ! Croquant la pomme au jardin d’Éden, on a pris conscience qu’il ne suffisait pas de vivre pour vivre, qu’il ne suffisait pas d’être vivant pour être vivant. Et tant pis pour le paradis ! Mieux vaut être maudit et vivre joyeusement dans la douleur et l’affliction, que de rester désolé de toute connaissance, assujetti à une joie béate.
Le rétrécissement de cette marge, cette marge qui fait de nous les artistes de nos propres vies, qui fait fuir tant de réfugiés de chez eux dans l’espoir de la trouver ailleurs, qui donne à espérer à la jeunesse de chaque époque et pousse le prisonnier à fomenter des évasions, cette marge sans laquelle l’existence ne serait qu’une exécution de besoins premiers en aucun cas à la hauteur de cette soif insatiable de l’infini au cœur de chacun, cette marge-là, son rétrécissement est la raison de notre égarement. Si le sens est un horizon, voilà que sa ligne semble s’être défaite de son sillon et, perdant ce qui la tendait d’ouest en est, voilà qu’elle se relâche brutalement et sous le choc, s’emberlificotant, se tortillant, s’entortillant autour de nous, elle est devenue labyrinthe, dédale. Perdant toute possibilité de rêver le temps, de rêver le futur, l’horizon nous tient désormais prisonnier.
Personne ne saurait lutter seul contre l’incertitude. Il faut alors avancer ensemble. Chacun devenant l’appui de l’autre dans un dédale dont nul ne connaît la superficie. Quand en sortirons-nous ? Nul ne peut répondre. Mais avancer chacun dans la capacité qui lui est propre. La nôtre, ici, consiste à être dans le récit, dans les histoires, dans le conte, dans l’oralité, dans la parole, dans la poésie de ce que parler veut dire.
Être théâtre comme on dit Être présent. N’oublions pas : pendant ce temps quelque chose continue de travailler en nous. Quelque chose, qui, indifférent à tout ce qui nous écrase, comme un enfant indifférent qui, blotti à l’arrière d’un bosquet, joue avec concentration avec le lacet de sa chaussure. Contre lui, aucun malheur ne peut agir. Quelque chose qui n’a pas besoin de nous, continue à vivre en nous. Pendant que nous nous inquiétons, que nous pestons, que nous nous plaignons, pendant que nous nous battons, que nous nous obstinons, pendant que nous désespérons, que nous reprenons espoir, pendant que nous sommes dans le présent si tumultueux de notre époque, pendant ce temps-là, quelque chose en nous, de plus grand que nous, de plus puissant que nous, et bien malgré nous, continue à travailler en nous. Et ce quelque chose, comme un extérieur quand nous sommes à l’intérieur, est précisément cet inverse qui nous aiguillonne. Poisson-soi qui nous appelle chacun par notre nom et dont les écailles miroitantes reflètent toujours notre image. C’est à ce poisson-soi que la langue de la poésie s’adresse et il est ainsi fait qu’il n’y a qu’elle qui lui parvienne, qu’elle qui lui soit compréhensible. Ainsi, au milieu d’un monde qui s’active pour soigner, pour faire travailler, pour enseigner, le rôle d’un théâtre est de produire des gestes et des actes dont le but premier est de faire entendre cette langue particulière, oxygène, survie des poissons-soi.
La parole poétique est une condition vitale à notre survie.
Mais elle ne peut surgir que dans le lien réel, entre celui qui parle et celui qui écoute. Voilà pourquoi, à la Colline, par fidélité au poisson-soi, nous faisons le choix de ne pas passer par la mise en ligne de captations de spectacles. Tout ce que nous offrons, consiste à créer un lien réel entre celui qui parle et celui qui écoute, comme on le dirait de celui qui avance dans le labyrinthe et celle qui lui a confié le fil pour qu’il puisse penser son chemin. Depuis toujours, la parole est le fil qui relie celui qui s’engage dans le cœur de son récit. Et comme nous avons donné à ce second confinement la configuration d’un labyrinthe, nous vous proposons de vous y engager avec la parole d’artistes et de spectateurs comme fil d’Ariane. Une aventure que vous pourrez choisir de tisser avec nous, soit en y participant soit en y assistant. Après les Poissons pilotes qui ont accompagné le premier confinement, il s’agit de faire de La Colline un métier à tisser engagé contre nos déchirures.
Wajdi Mouawad, 9 novembre 2020