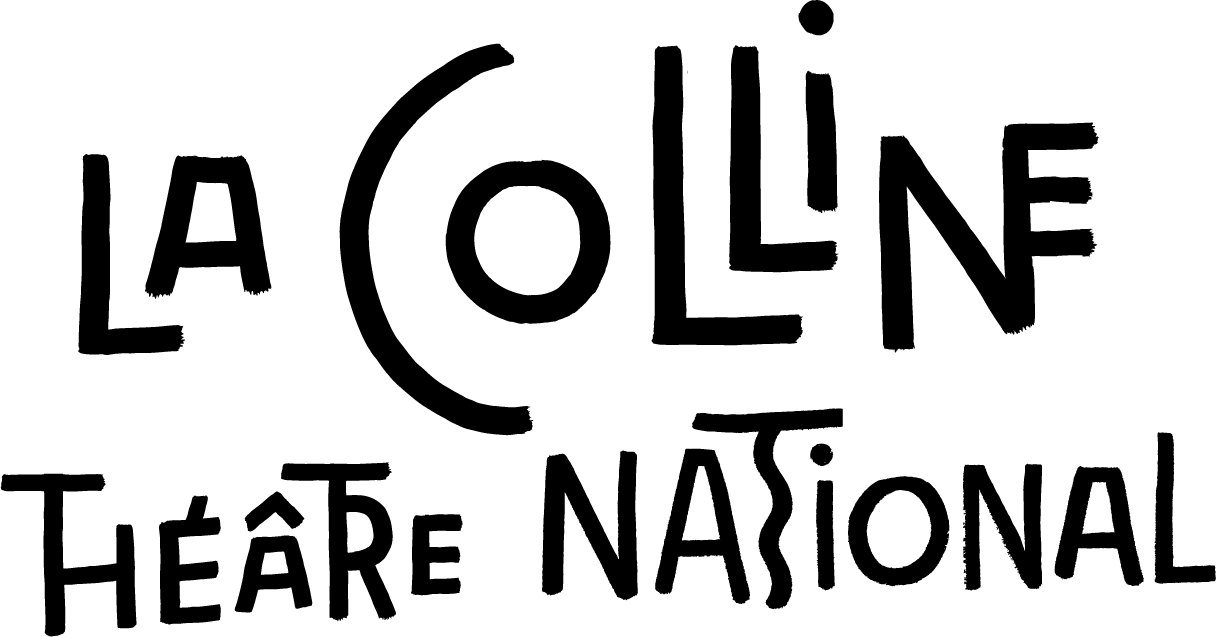[poème scénique]
les 21, 22, 24, 28, 29, 31 mars et 4, 6, 11, 12 et 13 avril à 20h
texte et mise en scène Julien Gaillard
Julien Gaillard, dont nous avons découvert La Maison en 2018, signe avec Last level v2 un poème cyberpunk qui convoque l’univers du jeu-vidéo. On y suit le parcours d’un personnage-candidat dans un monde éclaté dont il doit s’échapper. Son évasion, toutefois, prend assez vite un tour étrange. Le spectacle est une parabole, une courte épopée qui questionne l’aliénation humaine et les possibilités d’une émancipation politique et sensible.
équipe artistique
texte et mise en scène Julien Gaillard
avec Ruben Badinter, Marceau Ebersolt, Alix Henzelin, Eléonore Lenne, Adèle Marini, Enzo Monchauzou, membres de la 2e promotion de la Jeune Troupe de La Colline
scénographie, lumières, costumes Marjolaine Mansot
musique et design sonore Seb El Zin
Avertissement : Le spectacle comporte plusieurs minutes d’effets stroboscopiques.
durée 50 minutes
DANS MON CRÂNE
— Je saigne. C’est merveilleux. Je donnerais tout, tout pour sentir encore quelque chose.
Frappez-moi. Frappez-moi encore. Ouvrez-moi le crâne en deux. Branlez-vous dans mon crâne.
On gémit, quelque part.
_
Last level v2 suit le parcours d’un personnage (candidat) dans un monde hétérogène, éclaté. L’objectif principal de ce personnage est de quitter, par tous les moyens, les niveaux (levels) où il se retrouve brusquement projeté et enfermé. Il doit, pour gagner la partie – car il s’agit apparemment d’un jeu –, échapper aux pièges (leurres) qui se présentent à lui, tout en restant le plus virtuel, le plus évanescent possible. Il lui est strictement interdit de dépasser un certain taux de présence effective. Son existence doit être entièrement soumise à l’univers dans lequel il évolue. Rien ne doit échapper au contrôle de l’interface informatique. Au sein du jeu, tous les aspects de l’existence du candidat (corps, pensée, émotions) sont définis par les actions à accomplir. Aucun élément étranger ne doit corrompre la mécanique, la physique du gameplay. Le joueur n’est qu’un morceau du jeu.
Pourtant, quelque chose – une mémoire, une âme ? – commence à prendre corps sous la combinaison du candidat.
Last level v2 tente de donner à voir la naissance d’une sensibilité dans un monde qui interdit toute forme d’émotion réelle.
Poème
Last level v2 est un poème cyberpunk. Le futur y est à la fois tout puissant et inexistant, immobilisé. C’est un temps sans durée où la multiplication des gestes et des images est une manière de tromper l’inertie sidérée du monde. Temps fractionné des écrans qui ne cesse de donner l’illusion du mouvement alors que tout est irrémédiablement paralysé.
Poème, car c’est l’allure littéraire qui m’a semblé la plus à même de traduire cette réalité.
Last level v2 ressemble à un jeu vidéo. Il s’intéresse, en tout cas, à l’imaginaire vidéo-ludique, celui qu’une très grande part de la jeunesse mondiale fréquente à longueur de jours et de nuits. Il tente d’en proposer une syntaxe, littéraire.
Paysages adolescents
L’idée de ce texte m’est venue il y a une dizaine d’années après avoir animé un atelier de théâtre dans un collège des quartiers populaires de Paris. J’avais proposé aux élèves, durant la première séance, de faire un simple exercice, une sorte d’échauffement. Disposés en cercle, je leur avais demandé d’improviser un récit, cohérent, en se passant à tour de rôle la parole. Très vite l’exercice a déraillé : les morceaux de récit ne collaient pas entre eux, les élèves imaginaient des téléporteurs, des voyages dans le temps, des superhéros se déplaçant à des vitesses prodigieuses. Les unités de temps et d’espace ont été pulvérisées en un clin d’œil et la narration s’est défaite en une multitude de petites cellules d’actions indépendantes.
J’ai été tout d’abord déstabilisé par cet éclatement généralisé. J’ai tenté à plusieurs reprises de « recadrer » les élèves, puis, finalement, j'ai décidé de les laisser inventer, en toute liberté, leurs récits. En les écoutant, j’ai mesuré combien l’écart qui séparait nos imaginaires était important. J’ai aussi compris combien ma conception de la narration, « culturellement légitime » (Aristote and co), leur était passablement, voire tout à fait, étrangère. Combien ils étaient peu sensibles – en tout cas moins que moi – à la notion d’œuvre, d’unité, de progression logique, d’évolution, de dénouement, de vraisemblance, etc.
Durant la séance suivante, j’ai demandé aux élèves quels étaient leurs rapports à la fiction, aux images. Ils me déclarèrent quasiment tous qu’ils passaient la plupart de leur temps de loisir sur l’ordinateur, à regarder des vidéos, à naviguer sur les réseaux sociaux et à jouer à la console. Je compris, en les écoutant, qu’ils vivaient dans un flux d’images continu où se mélangeaient, indistinctement, vidéos brèves (amateurs, humoristiques), information, témoignages, jeux, films, séries, animés, émissions de télé… La frontière entre fiction et réalité leur était apparemment indifférente. (Ce qui ne signifie pas qu’ils étaient incapables de faire la distinction. Il y avait bien, entre toutes ces images, des différences, mais celles-ci étaient davantage rythmiques, dynamiques, graphiques que thématiques ou, disons, ontologiques. Le partage réel/fiction n’était tout simplement pas pour eux le plus important, le plus significatif.) Ces séquences d’images formaient en eux, aurait-on dit, une sorte de flux ininterrompu dans lequel ils évoluaient sans solution de continuité, comme un personnage de FPS[1]. Ces élèves étaient des bancs de montage ambulants. Ils ne cessaient de coller, plus ou moins consciemment, des images entre elles, de fabriquer des séquences vidéo à partir d’un matériau très hétérogène, impur.
[1] FPS : First Person Shooter, jeu de tir en vue subjective. Modèle, historique, du genre : Doom (1993).
Très vite, je me suis demandé à quoi pourrait ressembler une œuvre littéraire qui essayerait de coller à cette manière de voir et de vivre les images. Une œuvre qui tenterait, pour le dire simplement, de se mettre dans la tête d’un adolescent pris dans ce flux. Mais je ne souhaitais nullement mimer, réalistement, la psyché de ces jeunes gens. Ni proposer un texte à visée sociologique ou documentaire. Je voulais faire entrer dans la littérature des éléments qui à priori lui sont tout à fait étrangers, voire ennemis. Je dis bien : a priori, car ces productions imaginaires, consommées à grandes doses par les adolescents, s’inspirent fortement de structures narratives déjà existantes (qu’elles soient romanesques, cinématographiques, télévisuelles, ludiques…). Je voulais tenter de faire entrer à fond dans mon imaginaire – plus classiquement compartimenté que les leurs – ces manières, ces rythmes qui m’étaient relativement, et apparemment, étrangers. Apparemment.
Passionné par tous les types de production de l’imaginaire humain, des plus élevés aux plus triviaux, il m’a semblé important, pour ne pas dire essentiel, d’aller explorer une de ses matrices contemporaines les plus actives : le jeu vidéo. Et cela sans complaisance ni jugement unilatéral. Je ne suis ni un gamer ni un ennemi farouche des jeux vidéo. J’appartiens à une génération (née à la fin des années 1970) qui a vu s’installer – de manière certes rudimentaire, mais bien réelle – cette pratique. Et, surtout, je comprends parfaitement qu’on désire fuir par n’importe quel moyen la pesanteur de notre monde ultra-normé. Et cela même si le moyen adopté ne se révèle être, finalement, qu’une aliénation supplémentaire. (Pensez à l’usage des drogues dures pendant les années 1970-1980.)
Ces réflexions et observations ont donné lieu à l’écriture d’un premier texte Last level (v1), sous forme de récit.
Confiné
Last level v2 est-il un texte post-confinement ? Non, puisque j’ai commencé à l’écrire bien avant la pandémie (en 2011). Mais il se trouve que j’en ai achevé une première version durant cette période. Le texte porte donc en lui, que je le veuille ou non, les traces de la sidération mondiale provoquée par le virus du Covid 19. Mais je crois, j’espère que cette actualité ne situe pas définitivement le texte. Ne l’assigne pas à résidence. La pandémie est un de ses contextes. Un parmi tant d’autres.
Ce poème cyberpunk n’est pas étranger à mes autres textes. Il poursuit, à sa manière, mes questionnements, engagés depuis longtemps, sur l’aliénation humaine. Car c’est bien de cela qu’il s’agit ici. D’aliénation. Essentiellement. Et, par conséquent (par choix), d’un questionnement sur les possibilités de l’émancipation politique et sensible (si cela veut dire quelque chose).
Speed runner
Le personnage de Last level v2 ne cesse de s’évader. C’est l’objectif premier du jeu dans lequel il évolue. Son évasion, toutefois, prend assez vite un tour étrange. Elle semble le dépasser, aller plus vite que lui. Le candidat, emporté par son allure et comme guidé par un organisme étranger (disons : un virus) parasitant le scripte principal, se met à apercevoir des failles dans l'environnement où il évolue. Grâce à ces failles, à ces interférences, il se défait progressivement de la narration à laquelle son existence semblait irrémédiablement soumise. Une parole (syntaxe) singulière apparaît en lui. Le personnage et sa narration ne sont désormais plus raccord. La pensée du candidat, jusque-là étouffée par les injonctions du jeu, commence à se frayer un passage. Un corps et une mémoire se mettent à percer le tissu des gestes et des paroles préétablis. Malgré les reboots de la machine narrative, le candidat tente, de manière toujours plus décisive, de faire dérailler le programme de son avancée.
Last level v2 est peut-être une parabole. Les questionnements sur l’émancipation y sont essentiellement des problèmes de langage. De coupe, de retranchement, de branchage et de prolifération.
Cette version du texte v2 a été spécialement écrite pour la Jeune Troupe qui l’interprétera.
_
Julien Gaillard
Ce qui me préoccupe, c’est de savoir comment un texte peut devenir réalité indépendamment du comédien qui le prononce. Quand Pina Bausch place un hippopotame sur la scène, il devient le protagoniste. Certes, cela heurte les conventions, crée une déchirure, et c’est bien, mais ce n’est pas une solution, seulement l’indication d’une recherche de relation immédiate du théâtre et de la vie. Comment faire d’un texte un hippopotame ? Les textes doivent devenir une réalité qui ne se contente pas de représenter mais permette d’approcher la nostalgie ou l’intuition d’un autre possible.
Pour y parvenir il faut briser le cadre du théâtre tel qu’il est donné ne serait-ce que par l’architecture du bâtiment, c’est-à-dire par les structures politiques. Le texte ne doit pas être transporté comme une communication, une information. Il doit être une mélodie qui circule librement dans l’espace. Chaque texte possède un rythme, certes seulement sous-jacent, mais assez sensible pour être, comme dans un concert pop, reçu par les corps. C’est une telle qualité que le théâtre devrait retrouver, mais pour cela il faut de très bons textes. Les bons textes vivent de leur rythme et distillent leur message à travers ce rythme et non par la transmission de l’information.
Pendant la Renaissance élisabéthaine, on débitait en deux heures ou deux heures et demie les pièces de Shakespeare qu’on joue aujourd’hui, sans coupure, en quatre ou cinq heures. Tout n’était que rythme, tout n’était que tempo. Personne ne pensait à ce qui signifiait telle ou telle phrase – on pouvait s’y arrêter, après coup, si on en éprouvait le besoin. Cela aussi est un produit des Lumières, de croire constamment qu’il y a des choses à comprendre au théâtre. Mais la tête n’a pas de place au théâtre, car alors on ne fait pas d’expérience. On ne peut en faire qu’en étant aveugle. Une caractéristique essentielle de la culture européenne réside dans cette tentative permanente d’ôter aux gens la faculté de faire des expériences.
_
Heiner Müller, Fautes d’impression