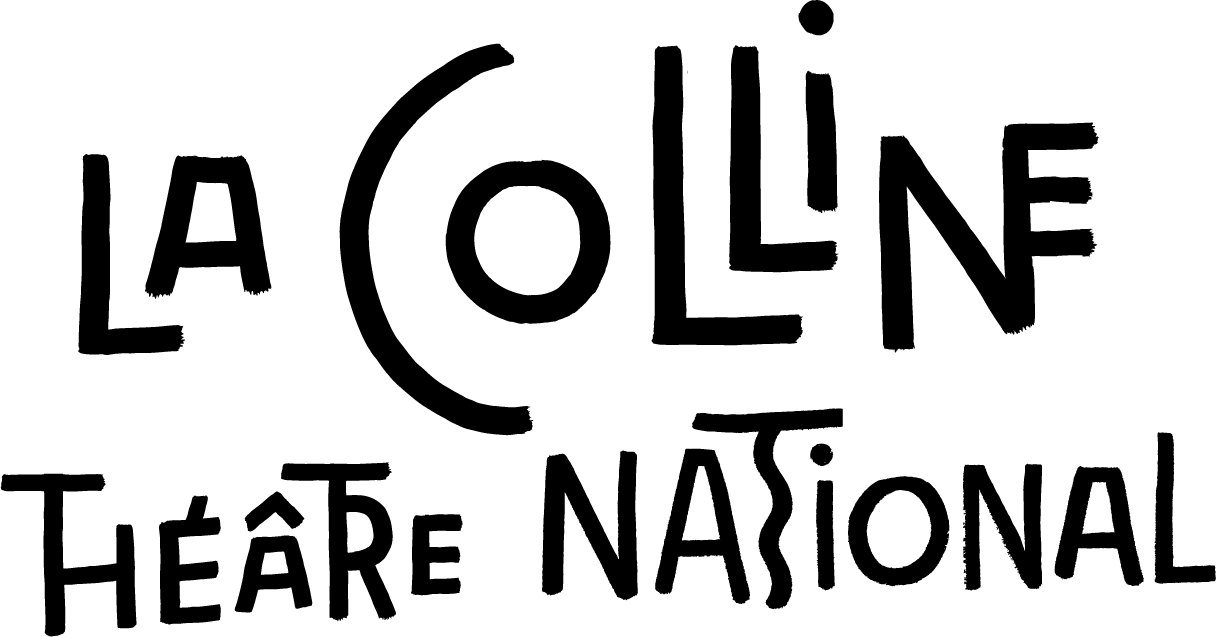manifeste 2019
On peut dire aussi de notre temps qu’il est celui de « l’opinionisation»: tout un chacun tient à avoir des idées sur tout et ne démordra pas de sa « petite opinion» qui vaut bien celle de son voisin, voire du spécialiste. Rares sont les gens qui se donnent la peine de s’informer sur un problème et encore moins d’y réfléchir, mais cela n’empêche personne de tenir que tout problème, si ardu soit-il, peut être réduit à une alternative extrêmement simple du ressort du « sens commun ». […] On voit ainsi se constituer une forme de liberté plus peureuse encore que celle qui esquive les prises de position politique au nom d’un scepticisme douteux ou que celle qui conduit au repli sur soi. Le degré suprême de la démission est atteint avec l’invocation de la «liberté» comme justification du refus total de s’engager et de se risquer sur quoi que ce soit au-delà du petit périmètre de la vie quotidienne et de sa petite opinion. Si le principe que « tout se vaut » procède de la maxime traditionnelle qu’« il faut vivre sa vie », il lui donne une portée toute nouvelle : l’ouverture d’esprit est aujourd’hui devenue un gouffre béant.
La Culture du pauvre
Richard Hoggart, 1970
Nous voici, pour beaucoup, devenus la propriété des villes. Dès notre naissance, le monde urbain nous domine quand nous pensons le contraire. Dans nos villes occidentales, rien qui ne soit décidé par une autorité administrative : tels arbres le long de telles voies, tels espaces verts, tels travaux dans telles rues, telles canalisations, nombre approximatif de pigeons, périmètres, cadastres, réseaux souterrains, surfaces des terrasses, hauteurs des trottoirs, teinte des réverbères, positionnement des poubelles, mobilier urbain. Rien qui ne soit voulu, pensé, étudié spécifiquement, adossé à une législation. Dans ces villes, nulle chance de tomber sur un figuier sauvage, un champignon inattendu, nulle chance de croiser une bête inapprivoisée ou un minéral n’appartenant à personne, rocher à tête de singe
Nous sommes esclaves d’une administration vorace dont nous croyons être les maîtres. Nous nous sommes tant éloignés des clairières où les choses s’ordonnent selon une
que, pour un grand nombre d’entre nous, les bois et les forêts sont devenus un arrière fond. Ce ne sont plus des lieux qui nous ont vus grandir ni ceux où nous élevons nos enfants, mais une réminiscence, au mieux un appel fantasmatique, un projet pour après la retraite, paysages où, de temps en temps, les week-ends on va faire un tour.
Nulle envie ici de prôner un retour aux sources, encore moins de dire « qu’avant c’était mieux », mais de constater, du moins pour ce qui me concerne, combien l’élévation, la méditation, la rêverie, tout cela qui exige effort des sens, dépassement, patience, ne passe plus par cette contemplation de la nature si chère à Novalis. Nous inventons de moins en moins nos vies tant la complexité de leur organisation et leur déploiement dans la grille du temps nous
Sans plus d’espace pour rêver, pour flâner, pour méditer, pour penser, nous sommes aliénés à une administration perpétuelle. Même nos enfants sont devenus des objets à organiser, quadrature du cercle des familles monoparentales. Et nous savons y faire. Nous sommes devenus experts, des
rompus à ces manoeuvres incessantes, où périodes de travail succèdent aux vacances. De Pâques à l’été, des ponts de mai à la Toussaint, toute délicatesse calendaire trouve toujours sa résolution dans l’engrenage gestionnaire et parfois même deux ans à l’avance. Chutant ainsi d’un calendrier à un autre, nous sommes prisonniers d’une rhétorique qui n’a de cesse de nous projeter vers le futur. Qui parmi nous saurait affirmer vivre au présent de sa vie ? Ce présent qui signifie être simplement là, sans souci du lendemain, sans connaissance du lendemain, dans l’indifférence du lendemain ? Tout entier rivés à notre organisation, nous ne savons plus ni ce que nous ressentons ni ce que nous éprouvons. Nous ne sommes que très rarement dans l’instant, si souvent absents à nous-mêmes. Des professionnels de
impassibles au milieu de la foule compacte des RER immobilisés aux quais des stations pour cause de régulation, d’incident voyageur, de grève ou de colis suspect. Et nous ne disons rien, nous prenons sur nous, nous respirons lentement, tant nous avons intégré combien il est inutile de paniquer, combien il est peu productif de nous énerver, ridicule de nous révolter. Nous savons que, quoi qu’il en soit de nos états de fébrilité, la mécanique et l’organisation de cette mécanique seront toujours les plus fortes, auront le dernier mot. Et qu’importent les messages enregistrés pour nous remercier de notre
Au bout du compte nous nous retrouvons à nouveau embourbés dans le cambouis de ce roulement qui, au fil des jours, vide de son sens la conjugaison du verbe vivre.
Et cette impassibilité, cette impossibilité à agir font de nous des proies déréglées dans leur instinct de survie, des proies paradoxales. Contrairement à l’antilope qui jette toute sa puissance dans sa course pour fuir son prédateur, nous, au contraire, nous fuyons en courant vers ce qui nous dévore, médias, réseaux sociaux, achats en ligne, numérisation de nos données, détérioration du monde, Excellisation névrotique de nos vies, et toujours le béton. Dès lors, tout en regimbant, tout en nous plaignant contre elle, aux portails de nos camps de travail nouveau genre, nous forgeons chaque jour cette sentence à laquelle nous ne croyons pas mais que nous déifions du matin jusqu’au soir : « La consommation rend libre ».
Pour autant, dans ce monde si hermétique, esclave de ses cadres, consommer ne semble plus suffire pour calmer ou apaiser ce
en nous qui supporte et se tait. Serait-ce le besoin d’expurger les frustrations qui nous dévorent
qui a fait surgir une forme inattendue de puritanisme ?
Un puritanisme camouflé qui, sans dire son nom, nous serine à chaque pas :
« Tu es un homme de principe, tu es un homme droit, un féministe, pour l’égalité, pour la pluralité, tu es un être libre, ouvert d’esprit, tu manges bio, tu vas au théâtre, tu recycles, tu aimes les œuvres contemporaines mais tu t’intéresses aussi aux classes populaires (d’ailleurs ton grand-père était marbrier en usine), tu es pour l’écologie et pour la planète, tu trouves que le gouvernement américain est horrible, tu es pour le peuple palestinien, tu es pour tout ce qui est juste, tu n’es pas antisémite mais tu es contre la politique du gouvernement israélien, tu es pour tout ce qui est bon, tu es laïque, tu manifestes quand il le faut, tu votes à gauche, tu es pour les commémorations, pour les réfugiés, pour les Syriens, contre le président turc et ton opinion envers la personnalité du président Russe est affirmée. Bref, tu es un être qui n’est esclave d’aucune morale, tu n’es pas puritain ni rétrograde, tu es quelqu’un à qui on ne la fait pas ».
Une chanson douce et agréable mais qui cache un tabou : ce
humilié, impatient, exige régulièrement le sacrifice d’un coupable.
Un coupable en mesure d’assouvir cette conviction que nous avons d’être nous-mêmes victimes, un sacrifice capable de répondre au sentiment d’injustice qui nous habite.
Harcèlement, agression, corruption, gare à qui, aujourd’hui, commet
car alors, ce ça caché, ce ça enfoui sous le tapis des morales, enfoncé au fond des armoires des désirs inexprimés, ce ça refoulé, qui n’en peut plus de cet esclavage auquel il se soumet, ce ça-là ressurgit avec une violence d’autant plus puissante qu’il prend la forme d’une indignation vertueuse.
n’est audible, plus rien n’est possible. Ce n’est pas un déluge, c’est la nuée de sauterelles contre laquelle il est inutile de lever son mouchoir. Il faut se baisser et attendre. Attendre que soit dévoré le coupable désigné. La violence est inouïe, d’autant plus effrayante que celui-ci n’a pas droit de parole, ni lui, ni ses enfants, ni les enfants de ses enfants. Il ne lui reste qu’à tenir son rôle. Être dans la géhenne. La foule invisible refuse d’entendre et lynche avec la même violence qu’elle prétend dénoncer. Et rien, rien qui puisse faire entendre raison. Jusqu’à l’hallali. Si l’élévation consiste à dépasser nos abîmes, le confort de nos villes ne semble pas d’une grande aide lorsque nos morales sont remises en jeu.
Arrivé à ce point de la réflexion, on pourrait s’attendre à voir s’écrire la phrase suivante : face à cette violence et dans l’absence de la nature, l’art se pose en rempart et là où il n’est plus possible de contempler un arbre depuis le centre d’une clairière, il est possible de contempler un tableau depuis le banc posé au centre d’une salle d’exposition. Oui. Mais ce serait se tromper grandement sur la nature de l’art et sur la férocité de la violence de ces morales. Quelle oeuvre d’art saurait nous défendre contre la violence dont nous sommes capables ? Face au danger que représente cette violence, seuls peuvent se dresser comme remparts la justice et la loi à laquelle cette justice s’adosse. Dans le choix démocratique, il ne peut y avoir d’autre solution que ces lois et les institutions judiciaires qui les appliquent. Aussi imparfaites soient-elles, elles tracent des lignes claires.
La peine de mort est abolie en France. Le droit à l’interruption de grossesse existe, le mariage pour tous existe. Ces lois ne font pas l’unanimité, elles soulèvent des oppositions morales brutales et c’est précisément parce qu’elles ne font pas l’unanimité que leur existence est cruciale. Là où nous ne parvenons pas à nous entendre, la justice impose une seule et même loi pour tous. Que cela nous plaise
ou non.
sauve nos démocraties. La morale, la religion, la culture, ne sauraient justifier que l’on viole la loi. Cela nous ferait basculer irrémédiablement dans
de la vengeance. Tuer un coupable reconnu de meurtre parce que l’on ne saurait imaginer qu’après son crime il puisse continuer à vivre, quand bien même il aurait purgé sa peine, ou, pour des raisons religieuses empêcher une femme d’interrompre sa grossesse, sont aujourd’hui des gestes que la loi interdit. C’est insupportable à entendre pour une société de plus en plus aliénée à son identification avec la victime mais sans cette impartialité que nous offre la justice, notre monde dépourvu de spiritualité, éloigné de la nature, sombrerait aussitôt dans
des guerres civiles où la justice appartiendrait aux plus forts. De tout temps il a toujours été plus simple pour les humains de se venger. Aujourd’hui plus encore qu’hier grâce à la puissance des médias et des réseaux sociaux qui ont su si bien remplacer prêtres, imams, rabbins, en nous disant, chaque matin, que penser, qui accuser et qui sacrifier.
Comment, après tout cela, situer un théâtre national voué aux écritures contemporaines ? Sinon en cherchant à échapper au rôle de juge que cette moralisation veut imposer. Car si, en tant que directeur, je ploie devant cette pression, comment faire entendre que le rôle de l’auteur consiste précisément à placer le spectateur en flagrant délit d’empathie envers le coupable autant qu’envers la victime ? D’une manière ou d’une autre, la plupart des pièces interroge la question du mal en mettant en scène un sacrifié, un condamné, un méchant. C’est la fonction du théâtre depuis les tragédies grecques. Comment alors jouer et défendre ces personnages ? Comment jouer Créon, Les Bonnes ou Zucco sans les comprendre et les aimer ? Mettre un coupable sur scène c’est forcément se rapprocher de lui. C’est approfondir notre perception de lui et se dire que ce LUI pourrait être MOI.
Sortant du théâtre, si l’on a cru et pris part à ce que l’on a vu et entendu, comment retourner à la morale du lendemain et exiger le lynchage du premier coupable offert sur le plateau médiatique ? Comment relier ce qui est vécu face à l’oeuvre d’art à la transformation que cette expérience opère dans la vie de tous les jours ? Comment ne pas être
entre le réel qui surgit de la poésie des écritures et la réalité du quotidien ? Comment réenchanter la relation entre art et vie ? Comment croire vraiment à la puissance de l’art ?
Wajdi Mouawad
Septembre 2018