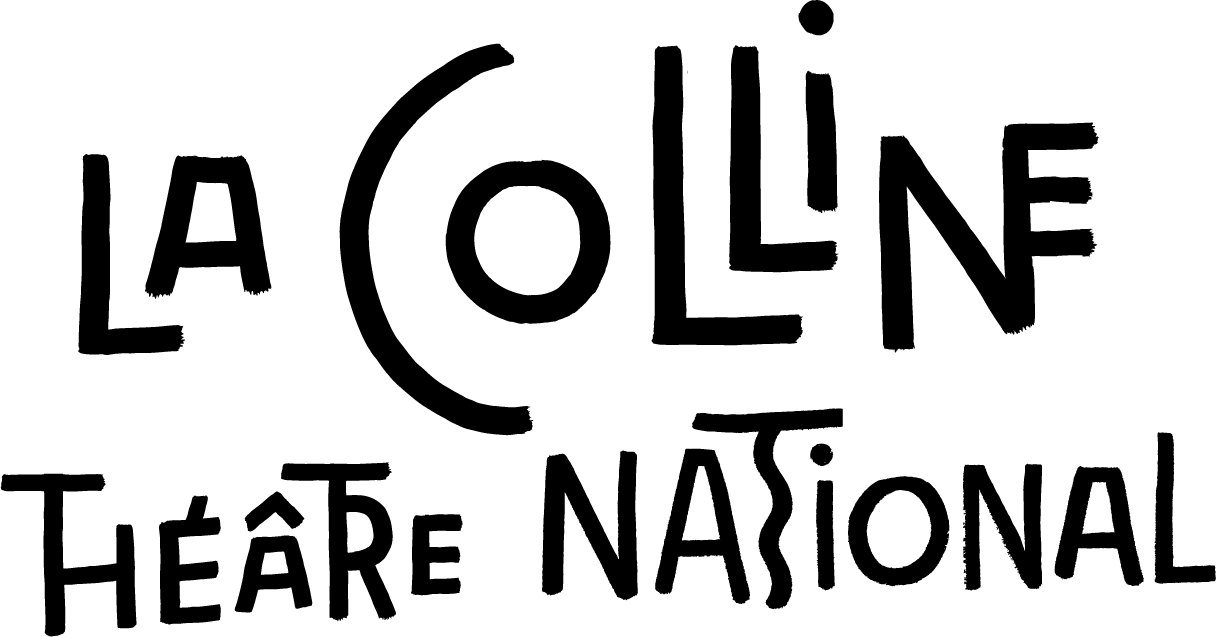Entretien avec Penda Diouf et Maëlle Dequiedt
Chérir son imaginaire
Entretien avec Penda Diouf, autrice et Maëlle Dequiedt, metteuse en scène
Que raconte la pièce Gorgée d’eau et comment est-elle née ?
Penda Diouf – Il s’agit d’un récit sur l’émancipation d’une adolescente, sur la traversée de cette période propice à la prise d’indépendance. Le spectateur découvre l’histoire d’une collégienne et de son rapport fusionnel avec sa mère. Au fil de l’intrigue se dessine la prise de conscience par cette jeune fille de la toxicité de cette relation filiale à laquelle elle tente d’échapper. La pièce porte un regard sur cette période si particulière pendant laquelle nous découvrons les défauts de nos parents, observons leur façon d’interagir avec nous et comprenons ce qui peut nous mettre à l’aise. En parallèle de cette relation mère-enfant, j’ai souhaité intégrer une réflexion sur l’écologie. Durant l’été 2021, j’ai été bouleversée par le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et cela a beaucoup influencé mon processus d’écriture. J’ai alors pris conscience que la nature pouvait devenir un troisième personnage en tant que tel. Cette volonté de parler d’environnement fait écho à la politisation de la génération actuelle, les jeunes se sentent concernés par l’état du monde. Il était primordial d’aborder cette question avec eux, et d’affirmer que le théâtre est aussi en prise avec la société dans laquelle ils évoluent. Ainsi, tout le récit se déroule durant une période de grande sécheresse. Une citation
d’Antonio Gramsci, que j’affectionne, traverse selon moi la pièce : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et c’est dans clair-obscur que surgissent les monstres ».
Comment avez-vous abordé ce texte du point de vue de la mise en scène ?
Maëlle Dequiedt ‒ Gorgée d’eau est un texte qui pose à la mise en scène un certain nombre de défis : comment représenter au théâtre une pluie d’oiseaux, un déluge, ou la transformation d’un personnage en arbre ? Le dispositif Lycéens citoyens propose, lui, de sortir de la boîte noire du théâtre pour amener le spectacle dans les classes. Cette proposition presque antinomique, a été à l’origine de ma réflexion : comment déployer cet univers fantastique avec une si grande économie de moyens ? En travaillant sur le texte se sont manifestées les différentes strates de sens. Ainsi, que raconte cette métamorphose en arbre ? Est-ce une histoire de disparition, d’émancipation, d’enracinement ? Comment s’explique cette pluie d’oiseaux ? Du dérèglement climatique, d’un délire d’angoisse, d’un mauvais présage ? La force du texte de Penda Diouf est d’entrelacer tous ces enjeux et thématiques, sans donner raison à une interprétation univoque. La question environnementale est latente, sans qu’il y soit fait allusion de manière frontale. C’est par le prisme des individus, de leurs réactions, de leurs vécus qu’elle est traitée. La relation mère-fille est également apparue comme centrale : relève-t-elle d’un amour fusionnel, d’une situation d’emprise, d’un conflit générationnel ? Dès lors, j’ai tenté d’ouvrir la représentation à ces multiples interprétations. Dans la construction de ce monde partagé entre la mère et la fille, la parole est apparue première, performative. C’est par les mots et les récits que la mère transmet à sa fille son expérience, sa vision du monde, mais aussi ses blessures ancestrales et ses angoisses. Et c’est par la parole que la fille développe son interprétation des événements et construit son émancipation.
Le texte navigue entre le réel et le fantastique. Que révèle cette cohabitation des univers ?
P.D. - L’histoire se déroule dans un monde au bord de la rupture, cela permet d’intégrer des scènes où la frontière entre réel et fantastique est trouble. Cette ambiguïté entre deux espaces provient en partie de mes expériences personnelles. À titre d’exemple, la scène de la pluie d’oiseaux est inspirée d’une anecdote qui m’est arrivée à Strasbourg. Un soir, au beau milieu de la cour intérieure de mon immeuble, je découvre un moineau mort. Le deuxième jour, c’était un merle, exactement au même endroit. J’ai ensuite rêvé d’une scène similaire. Après des recherches, j’ai découvert que des « pluies d’oiseaux » s’étaient déjà produites un peu partout dans le monde à la suite de contaminations de l’eau ou de l’air. J’ai alors choisi de faire de cette scène un moment de transition dans la pièce, un événement qui se place entre deux temporalités.
M.D. – Lors des répétitions, nous avons découvert de quoi étaient porteurs les mots, ce que recelaient les images. Si l’univers de la pièce est parfois fantastique, nous nous sommes attachées avec les actrices à rester très concrètes dans les situations entre cette mère et sa fille qui vivent seules, en tête-à-tête. Leur environnement devient de plus en plus menaçant car elles sont soumises aux aléas du monde extérieur. Nous nous sommes alors intéressées à la frontière entre le rêve (ou le cauchemar) et la réalité ainsi qu’à la dimension mentale et psychologique de ce huis-clos. À quel moment bascule-t-on du côté de leurs visions intérieures, nourries par leurs peurs et inquiétudes ? À quel moment s’inventent-elles des
fictions et des jeux pour résister à ce monde inquiétant et hostile ? Le personnage de l’adolescente abandonne progressivement les histoires héritées de l’enfance pour entrer dans la vie d’adulte. L’ennui et peut-être l’exclusion qu’elle connaît au collège lui donnent l’occasion d’un refuge dans l’imaginaire. Avec Lise Lomi, qui interprète l’adolescente, nous avons travaillé sur cet espace solitaire, sur ce qu’il produit de bénéfique, de créatif, et sur la représentation du mouvement intérieur des êtres. L’univers fantastique nous permet également de donner à voir des émotions plus négatives, les états d’angoisse et de doute des personnages. Les passages entre le réel et le cauchemar soulignent avec plus de force le traumatisme et les non-dits, accentués par la création sonore de Joris Castelli. La bande-son réalisée, entre bruitages réalistes et transcriptions technologiques, se joue de nos perceptions et participe à la création de cet univers mental.
P.D. – Face au traumatisme et aux inquiétudes des personnages, Gorgée d’eau est tout de même un texte porteur d’espoir, de sensualité, et d’apaisement dans une certaine mesure. Plusieurs scènes ont été pensées comme des graines à la contemplation, comme lorsque la mère réveille sa fille pour qu’elles observent ensemble les étoiles. C’est une invitation à être dans l’instant présent. La pièce se fait l’écho de nos tentatives quotidiennes d’être en empathie et en solidarité avec les autres et invite à chérir son intérieur et son imaginaire.
Qu’incarnent les différents lieux du récit et notamment le collège ?
P.D. – Dans le texte, le collège n’est pas un lieu hospitalier. Il est l’hôte des premières fois (découvertes scolaires, théoriques, premiers émois amoureux) et représente également un espace de discrimination, de lutte sociale, de hiérarchie de popularité. Le personnage de l’adolescente ne suit pas les codes, elle ne joue pas le rôle exigé et se retrouve par conséquent dans une position assez passive dans l’établissement. Cela s’explique aussi par les injonctions de sa mère, qui lui répète de ne pas trop s’approcher des autres. Il y a chez elle un réflexe d’observation,
une attention aux rumeurs. J’ai choisi intentionnellement que ce personnage soit collégienne et non pas lycéenne, car elle est plus jeune que les participants au programme Lycéens citoyens et je souhaitais que les élèves spectateurs puissent ressentir une certaine empathie, s’imaginer qu’elle est leur petite soeur, et éprouver une envie de protection à l’image de ce que la mère ressent pour sa fille. Je n’ai pas écrit spécifiquement pour des adolescents mais j’aime m’adresser à eux.
M.D. – Avec Heidi Folliet, scénographe, nous avons voulu créer un espace gigogne qui accueillerait différentes strates de sens, qui ne serait jamais celui qu’on croit au départ, comme en permanente mutation : une salle de classe, une serre de jardinage, un sous-bois, le jardin, la salle à manger. Tous ces espaces sont poreux et cohabitent, renforçant le sentiment d’enfermement et d’étouffement ressenti par l’adolescente. La coexistence des lieux intérieurs et extérieurs nous permet également de concrétiser cette idée d’une nature ambivalente : à la fois ressourçante, notamment pour la mère qui cultive son bonsaï et entretient un lien fort à la terre, et menaçante par la sécheresse, le manque d’eau et l’invasion de ce bonsaï.
Vous connaissiez la distribution avant même d’écrire la pièce, cela a-t-il influencé votre écriture ?
P.D. – Oui ! C’est la première fois que cela m’arrive et cette contrainte a été très enrichissante. Je connaissais le travail de Nanténé Traoré, qui interprète la mère, et j’avais très envie de la retrouver avec ce texte. Maëlle a proposé de convier la comédienne Lise Lomi, ce qui m’a tout de suite séduit. Ma priorité était de leur écrire des rôles avec suffisamment d’espace pour qu’elles puissent s’approprier les personnages. C’est pourquoi certains passages du texte laissent une grande liberté d’interprétation et d’autres sont plus écrits, plus dirigés. La pièce varie constamment de focale en posant parfois un regard très intime sur les personnages, et à d’autres moments en s’en s’éloignant afin de raconter une histoire plus générale. C’est cette ambivalence que je souhaitais créer et je savais que Nanténé et Lise pouvaient porter au plateau cette complexité.