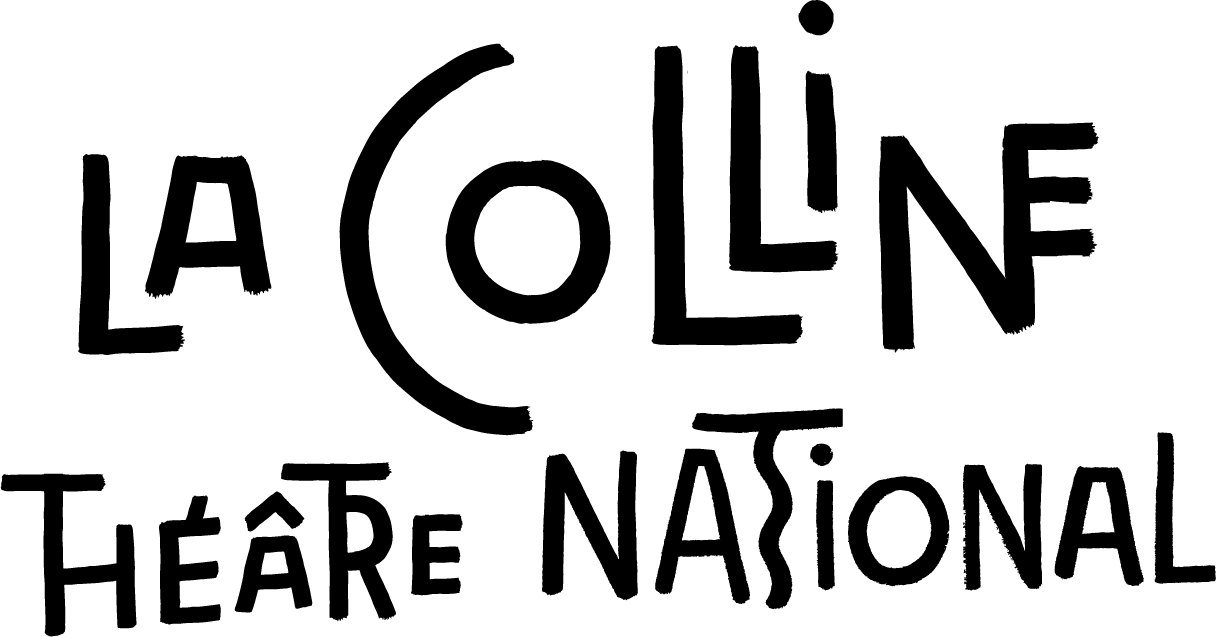Entretien avec Khalil Cherti
L’imagination : l'au-delà de soi
Quel est votre parcours des écrans à la scène ?
J’ai commencé par les écrans : j’ai appris en faisant de petits films institutionnels, tour à tour assistant, derrière la caméra ou au montage. Cela me plaisait d’œuvrer dans cet artisanat. Puis j’ai été embauché en tant que réalisateur sur des films pour de grands événements ou des causes nationales avant d’oser passer à l’acte de création personnelle sur des courts et moyens formats, jusqu’au court-métrage T’embrasser sur le miel. J’ai senti que sa forme était particulière dès le démarrage de l’écriture, elle appelait le théâtre.
Malgré le confinement qui a entravé la diffusion du film, j’ai réussi à le montrer et La Colline m’a proposé de faire un premier laboratoire de recherche en 2022, qui m’a permis de me découvrir en tant que metteur en scène de théâtre. En effet, même si je n’osais pas me l’avouer, mon désir de spectacle vivant a toujours été présent. Alors que le cinéma dit classique cultive le règne de la narration – on contractualise presque avec les spectateurs le fait de raconter une histoire –, la première des choses sur laquelle on échange avec ceux de théâtre concerne l’imagination. Et cette entrée-là change tout, elle ouvre un autre monde, sans limites. Alors qu’on a évidemment moins de moyens qu’au cinéma, l’espace-temps devient infini. Ce qui rend la relation du spectacle et de sa troupe au public plus intime, puisque c’est à travers l’imaginaire de chacun que ce spectacle va exister. Par ailleurs, le théâtre permet une plus grande hybridation des formes, des registres, des moyens d’expression que l’on peut convoquer. Tout est disponible et combinable : la musique qui peut être en direct, l’accessoirisation, la chorégraphie, les types de jeu et d’atmosphère… Presque palpable, la matérialité de ce langage protéiforme renforce l’aspect artisanal de la création qui va au-delà de la projection et permet de toucher du doigt l’imaginaire. Et je trouve cela incroyable, surtout dans le monde dans lequel on vit.
Vous vous dites artisan plutôt qu’artiste, quelle est pour vous cette distinction ?
Il est en effet plus facile pour moi de me considérer artisan plutôt qu’artiste. Certes pour me rassurer face aux figures de certains grands artistes alors que je suis autodidacte, mais surtout pour souligner un aspect éthique : une chance inouïe m’a été offerte de pouvoir écrire, mettre en scène et partager ce que j’ai dans le cœur avec les spectateurs. Mais cette opportunité est assortie d’un cadre budgétaire, d’une gestion d’équipe etc, et je me sens responsable des conditions économiques, écologiques, organisationnelles et humaines dans lesquelles je vais créer le spectacle. C’est en ce sens que je ne souhaite pas me revendiquer comme un artiste qui serait déconnecté des réalités, mais plutôt me comporter en bon artisan attentif au monde auquel il appartient pour lui permettre d’être plus créatif. Par ailleurs, il me semble qu’on ne peut pas se décréter soi-même artiste. Il serait plus juste de dire que c’est à travers les yeux, les cœurs et les imaginaires des autres que naît la rencontre avec une œuvre artistique.
Comment appréhendez-vous le travail ?
Je profite actuellement d’une période que j’apprécie particulièrement qui est celle de la création. Alors qu’au cinéma, la préparation est progressive et les équipes rarement présentes simultanément, c’est tout le contraire au théâtre : tout le monde est convoqué dès le départ et travaille, crée, imagine, se sent concerné, ensemble. Cela semble anodin mais cette situation concrétise des valeurs qui me sont chères et bénéfiques. Dire « une aventure collective, un travail d’équipe », ne sont pas simplement de bons mots, ce sont des actes quotidiens nécessaires et vitaux pour le spectacle. Cette solidarité de fait, où être bienveillant avec l’autre est dans l’intérêt de chacun, à cause de notre interdépendance continuelle, ressemble à une véritable cure de jouvence stimulante. Et je ne suis pas le premier à le dire, mais au théâtre, il n’y a pas besoin de discours, c’est dans le faire que ça s’incarne.
L’autre aspect que je trouve à la fois vertigineux et passionnant est qu’il s’agit presque de préparer un plan séquence en direct, c’est-à-dire a priori sans interruption. Et faire face à cette immense inconnue « Que va-t-il se passer pendant une heure et demie, et cela tous les soirs ? » donne un état d’esprit différent. Au cinéma, on essaie d’esquiver ce risque-là, l’inconnue n’a pas vraiment sa place. Au théâtre, nous courons vers cette inconnue, pour la découvrir ensemble. Alors il s’agit bien de spectacle vivant : non seulement parce que des êtres vivants font face à d’autres êtres vivants, parce que chaque représentation est unique, mais aussi parce que chacun a conscience que le spectacle peut connaître une mort prématurée. C’est cette possibilité de l’échec qui rend si vivant.
Quelle est l’histoire de la pièce et qu’est-ce qui vous a poussé à l’écrire ?
C’est l’histoire de Siwam et Emad qui habitent deux villes éloignées en temps de guerre et qui ne peuvent plus communiquer que par vidéos interposées. Mais ce ne sont pas des documentaires de leur quotidien ou de leur quartier, ce sont des petits numéros tels des spectacles qu’ils préparent et s’offrent l’un à l’autre, pour se tenir compagnie et résister au chaos qui les entoure. Plusieurs ont comparé cette histoire à un Roméo et Juliette syrien contemporain, alors que cet amour impossible n’était pas mon moteur d’écriture ! Mon désir premier était de plonger dans une situation où l’imaginaire n’est plus de la joliesse théorique ou abstraite, mais quelque chose de vital. Il relève de la survie pour Siwam et Emad.
D’autre part, côtoyant beaucoup d’amis syriens issus de la diaspora, je les observais recevoir des nouvelles uniquement par les réseaux et notamment des vidéos de leurs proches et je me trouvais en empathie avec ce qu’ils pouvaient ressentir. Plus la guerre avançait, plus je réalisais combien ces capsules devenaient la seule chose qui leur restait, le seul moyen de conserver un lien. Par opposition aux documentaires et actualités, légitimes mais incessants, sur la tragédie syrienne, ces images faisaient réapparaître la vie artistique et culturelle, l’inventivité et la lumière de ce pays. Dès lors, il me tenait à cœur d’avoir deux personnages qui sauvent leurs liens et eux-mêmes grâce aux créations qu’ils s’offrent mutuellement. Sachant que beaucoup de gens, d’où qu’ils viennent, peuvent se reconnaître dans cette situation, notamment depuis le confinement.
Le projet pourrait-il s’apparenter à une mise en abyme de l’acte de création ?
Je tiens dans le spectacle à ce qu’on assiste à la préparation des vidéos que les personnages fabriquent avec ce qu’ils trouvent à portée de main. On observe ces petits bricoleurs en train de créer, d’interpréter et de transmettre. Ainsi l’acte de création descend de son piédestal, puisqu’on n’en cache pas les préparatifs comme s’ils étaient sacrés. C’est ce qui me touche : la création n’existe pas pour elle-même ou pour être admirée pour elle-même, elle agit comme véhicule d’un lien unique.
Dès lors, je crois plutôt qu’au cœur du projet se trouve l’idée du partage. Qu’est-ce qu’on peut encore partager ? Que fait-on quand on ne peut plus rien ? Comment conserver un lien quand il ne reste rien d’autre ? Ce spectacle naît de cela : pour continuer à se tenir compagnie, les personnages passent par la création de saynètes l’un pour l’autre. Ce faisant, ils tentent de dire « Toi aussi, avec ton imaginaire, tu vas t’évader et pouvoir être au-delà de toi, de cette situation, de cet endroit. »
Pouvez-vous présenter les comédiens et raconter comment vous les avez rencontrés ?
Tout d’abord, il est intéressant de préciser que les comédiennes et les comédiens syriens sont majoritairement issus de deux écoles d’art dramatique réputées à Alep et Damas, avec une formation très solide destinée à déployer leurs œuvres – pièces, films et séries - à travers tout le Moyen-Orient. Malheureusement, avec la guerre, le régime a contraint la majorité d’entre eux à s’expatrier. Comédienne syrienne extrêmement reconnue dans le monde arabe, Reem Ali a cependant eu très peu d’occasions de faire valoir ses talents lors de son arrivée en France. J’ai eu la chance d’en prendre la mesure sur le tournage du court-métrage T’embrasser sur le miel. Elle va donc poursuivre son interprétation du rôle de Siwam, en explorant des registres de jeu extrêmement divers, clownesques, tragiques, ou romanesques…, mettant son savoir-faire au service d’un propos qui continue à lui tenir à cœur.
Pour Omar Aljbaai, l’histoire est assez « syrienne » si je puis dire, car belle, improbable, mêlant le tragique à une capacité de vie sidérante. Fils d’un auteur metteur en scène poursuivi par el-Assad père, Omar a également été traqué par le régime suite aux manifestations, emprisonné, avant de parvenir à fuir pour le Liban où il a vécu sept ans sans papiers ni moyens. Après l’explosion du port de Beyrouth, il a dû partir à nouveau, pour la Turquie cette fois, toujours dans une situation de grande précarité. Mais, tout au long de sa vie, que ce soit en Syrie ou pendant ses années d’errance, il n'a jamais cessé d'écrire, de mettre en scène et d'interpréter ses propres spectacles. Une fois en France, sa situation administrative s’est un peu stabilisée. Et comme les Syriens exilés fonctionnent en réseau de solidarité, l’une de ses amies lui a proposé d’interpréter un rôle dans un spectacle. Le hasard a fait que Reem, qui le connaissait en tant qu’auteur mais ne l’avait jamais vu jouer, a assisté à cette représentation. Et alors que je recherchais un comédien pour T’embrasser sur le miel, elle m’a conseillé de le rencontrer. Lors des essais, une sensation m’a habité : j’oubliais qu’il était en jeu, j’avais l’impression qu’il inventait les mots qui sortaient de sa bouche. Et en plus de réaliser qu’existait une complicité singulière entre nous, j’ai compris qu’avec tout le bagage accumulé depuis son départ de Syrie, il avait rendez-vous avec cette pièce. Une synchronicité, indépendante de moi, qui fait que cette pièce est pour lui.
Romain Gary a écrit « Rien ne vaut d’être vécu s’il n’est l’œuvre de l’imagination. » Quel est selon vous, ce pouvoir ?
À noter qu’il faut faire attention lorsque l’on associe le pouvoir à l’imagination : celle-ci n’est pas que positive, elle peut être machiavélique ! Rien qu’avec l’exemple du très inventif Elon Musk pourtant extrêmement dangereux, pour ne citer que lui...
Mais pour recoller à la phrase de Romain Gary et les vertus de l’imagination, il s’agit d’un pouvoir dont on devrait faire une cause nationale ! J’ai l’intime conviction que l’on devrait transmettre ce désir aux générations futures. On réduit trop souvent l’imagination au travail des créateurs, des chercheurs, des artistes. Et ça me dérange, car l’imagination accompagne la vie de chacun tous les jours. C’est grâce à elle qu’on peut accueillir, aller vers l’autre, inventer un lien renouvelé au monde. En ça, il est nécessaire de ne pas considérer l’imagination comme une chose abstraite, artistique, théorique ou philosophique, mais au contraire de prendre conscience que c’est une voie vitale à investir. Un enseignement, une inspiration, un souffle à partager le plus possible. L’imagination, c’est l’au-delà de soi dans toutes ses composantes. Ce qui rend la vie vivable et la mort accueillable.
En quoi cette pièce résonne-t-elle avec l’actualité ?
Quand j’ai écrit cette pièce, j’étais loin de me douter des événements récents en Syrie. Qui, qu’ils soient experts en géopolitique ou Syriens eux-mêmes, l’aurait d’ailleurs imaginé ? L’un des régimes dictatoriaux les plus violents depuis la Seconde Guerre mondiale s’est effondré en quelques semaines car le pays s’est libéré lui-même, et pour l’heure, sans effusion de sang mais avec une apparente acceptation de la diversité ! Et bien que nul ne puisse prédire l’évolution de la situation, rien que ce qui se passe aujourd’hui était inenvisageable il y a peu, la Syrie est peut-être en train de changer l’imaginaire collectif au moment où l’on en a besoin et de la part d’un endroit du monde pour lequel on avait peu d’espoir. Comme si l’actualité également nous rappelait le pouvoir de l’imagination, un écho troublant avec le spectacle !
De la même manière, la pièce suit le parcours des personnages pendant plus d’une décennie, du début des manifestations en 2011 jusqu’à nos jours, demandant continuellement : Qu’est-ce qu’il reste ? De ce pays ? De ce qu’on y a vécu ? Des souvenirs, des liens ? L’actualité pose également cette question de façon brûlante. Maintenant que le régime a chuté, le pays s’interroge sur cette question essentielle à la construction d’un avenir durable.
Selon moi, l’histoire contemporaine de la Syrie est presque mythologique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, elle bat tous les records : la dictature la plus longue, le plus grand nombre de torturés, le plus grand nombre d’enfants morts, le plus grand nombre de déplacés et d’exilés. Tous ces faits font de la Syrie un événement mythologique, dans le sens du « hors humain ». Une sorte d’histoire insensée qui se balade sans qu’on y prête attention, mais qui crée un précédent, qui habite la conscience collective. En ce sens, j’espère que dans ce spectacle, la Syrie puisse ne pas se résumer à un lieu ou une situation mais s’apparenter à un mythe : se diffuser sans qu’on ait besoin de la nommer et voyager en chacun, ce même après la fin du spectacle.
Entretien réalisé à La Colline en janvier 2025