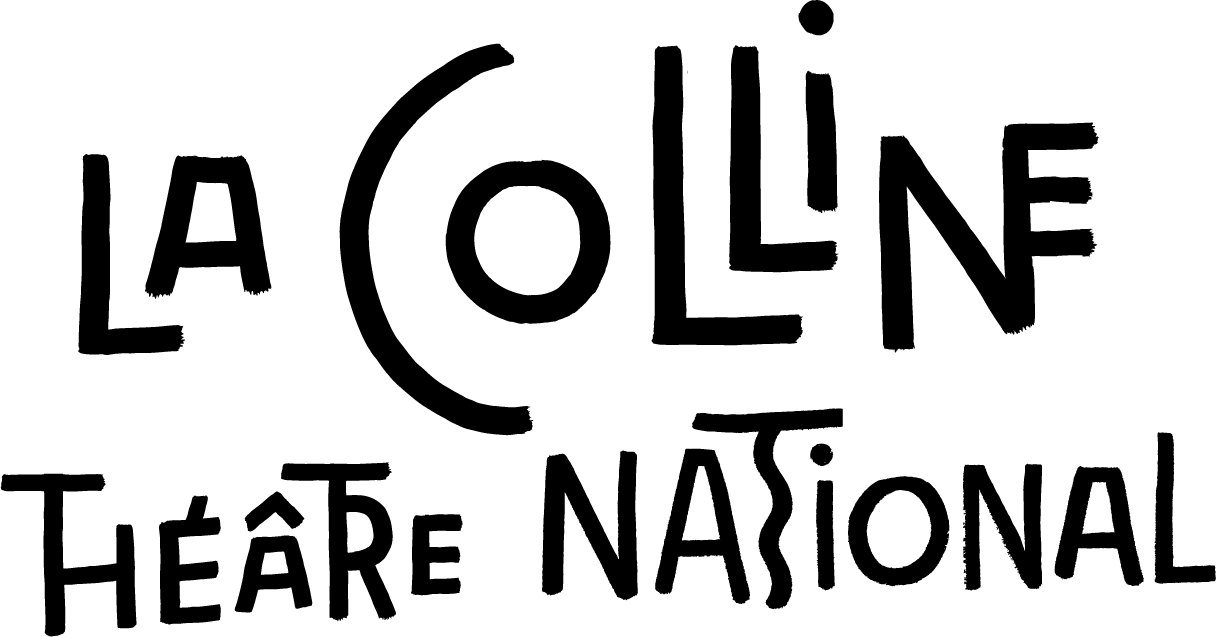Journal de bord des Jeunes Reporters 2023-2024
Mai : Le temps des hommages
A la mi-mai, les Jeunes Reporters ont été invités à parcourir l’œuvre de Laurent Gaudé, en commençant par sa nouvelle création Terrasses, mis en scène par Denis Marleau. La pièce revient sur les attaques du 13 novembre 2015, à travers les voix multiples de médecins, passants, otages, secouristes, victimes et leurs proches.
Dans quelle mesure tout un chacun est-il proche de cet évènement traumatique ? Où étions-nous cette nuit-là ? Au contact de la pièce, les souvenirs refont surface et l’écho de ce jour résonne au présent. Il nous renvoie à notre propre vulnérabilité, au fondement de notre Humanité.
Choisissant de s’inscrire dans une écriture poétique et fictive, sans volonté de témoigner par le documentaire, Laurent Gaudé construit un chœur opposé à la terreur, pour continuer, malgré tout, de tenir debout.
Ce temps fort consacré à Laurent Gaudé a permis aux JR de découvrir Le Tigre Bleu de l'Euphrate, le 30 mai dernier. Le Tigre Bleu, métaphore incarnant l’ivresse du pouvoir d’Alexandre Le Grand, son insatiabilité, la complexité d’un homme violent et compatissant, monstrueux et grandiose, mais aussi son lien à la mort, non pas ennemie mais accueillie avec vaillance. Alice Le Dantec nous évoque son expérience du spectacle :
"Denis Marleau met en scène le monologue d’Alexandre Le Grand écrit par Laurent Gaudé. Ce récit a tout de l’épopée, sa poésie, son merveilleux et ses personnages illustres. Porté par Emmanuel Schwartz, le personnage apparaît dans toute sa grandeur mais se dessine aussi, la vulnérabilité de sa condition humaine. Héros et hommes indissociables, c’est sans doute ce contraste qui est le plus touchant."
En mai, fait ce qu'il te plaît, si bien que les JR se sont immiscés aux Esquisses nocturnes de la Bourse du Commerce lors de la soirée du 24 mai. Une fois par mois, la Bourse du Commerce invite ses visiteurs à s'immerger au sein de ses expositions en dessinant, déformant et s'appropriant les œuvres de la collection. Maëlle nous partage son expérience des esquisses dans cette capsule vidéo et son dessin :
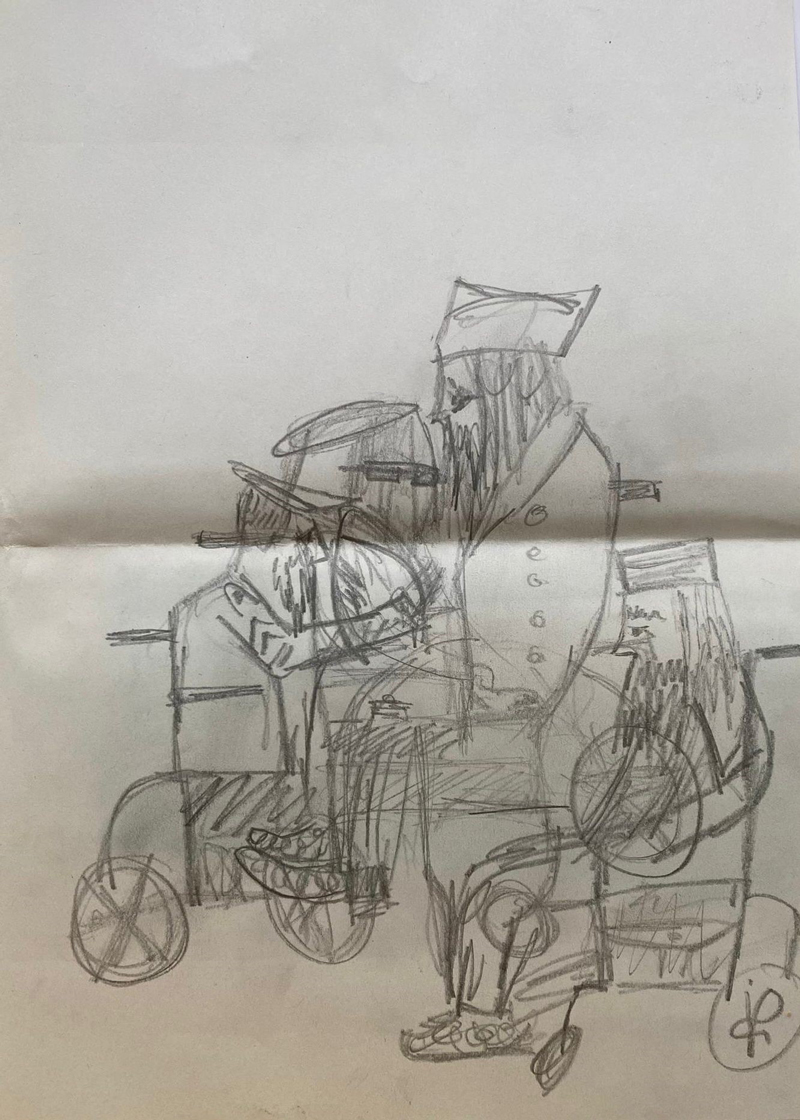 |
Si le mois de mai fut le temps des hommages, le mois de juin, lui, annonce des orages…
Avril : par-delà les murs
En avril, les Jeunes reporters se confrontent à de nouveaux espace-temps : la prison et l'abîme.
Ils se sont retrouvés pour la représentation d’Un Apprentissage par Pierre-Yves Chapalain, pièce qui questionne la quête de soi, la relation à l’autre et l’importance des moments de basculement qui bouleversent tout et créent un rapport renouvelé au monde.
Comment réapprendre à tisser des liens lorsque l’on a été cloitré entre quatre murs pendant un temps qui nous semble infini ? Que subsiste-t-il de l’absence d’un père pour un enfant qui a grandi ? Est-il possible que nos proches puissent devenir pour nous des étrangers ?
Le mot d’Anatole Brunet :
« Il n’est pas de temps pour apprendre.
Quand on apprend à l’enfant la vie, qui apprend l’enfance à celui qui est déjà dans la vie ? L’enfance, c’est la construction d’une maison qui nous protège des intempéries du monde. Mais parfois, les quatre murs de notre maison peuvent devenir les quatre murs d’une prison.
Il n’est pas de temps pour apprendre,
pour briser ces murs, les abattre. On commence par le quatrième en s’adressant à son enfant. Celui que l’on n’a pas vu, avec qui l’on n’a pas appris à vivre.
Il n’est pas de temps pour apprendre,
même ce que l’on a jamais eu le temps de faire ; apprendre à lire, à comprendre les mots, trouver les clefs du monde…
Il n’est pas de temps pour apprendre,
apprendre ce qu’est notre vie, coincé dans un horizon de préceptes avec la société comme barricade.
Dans la lueur de la lune tout retourner et apprendre à trouver ce que l’on croyait enterré à jamais, ce qui s’était éparpillé en chemin…
Il n’est pas de temps pour apprendre,
Apprendre à son enfant, devant lequel se dresse un monde friable, comment se construire.
Dans le temps où l’on agonise, il est temps de défier le destin et le déterminisme. Ce temps, c’est celui d’un Apprentissage. »
En avril, ne te découvre pas d’un fil au risque de tisser des nœuds solides, comme l’ose Gwenaëlle Aubry dans son roman La Folie Elisa. Les Jeunes reporters ont rencontré l’œuvre de la romancière, dont la recherche philosophique gravite autour des questions du sujet et de la puissance, en lisant ses romans La Folie Elisa, Personne et Partages.
Alice Le Dantec nous raconte La Folie Elisa, roman choral qui croise le destin de quatre femmes :
« Ce roman fait jaillir quatre voix. Quatre jeunes femmes, quatre artistes. Elles sont sculptrice, chanteuse, comédienne et danseuse. Toutes quatre au bord de l’abîme, elles tissent des nœuds, s’accrochent à des sursauts de vie, des morceaux d’histoire et des restes d’amours. Pour ne pas tomber. La matière vibre autour des personnages. Ce sont ces vibrations que l’on ressent dans l’écriture qui donnent au roman son intensité. Les sensations occupent cet espace laissé vide, déserté. Le corps est le seul lien entre l’être et le monde. Rien, en dehors, ne se tient. La logique, le bon sens, se heurtent à l’horreur du quotidien. La Méditerranée est un cimetière et Paris en novembre 2015 ne s’est pas encore relevé. Alors elles ont arrêté. De chanter, sculpter, danser ou jouer. Leur corps seuls reste, se déplacent dans un espace désarticulé, un vide vertigineux, à la recherche de sensations. Pour se sentir exister, enfin, se détacher des ombres, des absents et des cauchemars. »
Mars : la question de la métamorphose
En mars, le printemps est arrivé avec deux nouvelles pièces qui ont ouvert un autre champ de réflexion pour les Jeunes Reporters : la question de la métamorphose. Ils ont assisté ce mois-ci à Painkiller de Pauline Haudepin et Cavalières d'Isabelle Lafon, deux spectacles qui explorent chacun à leur manière les rencontres et les ruptures qui rythment et bouleversent nos existences, des ruptures qui nous déplacent, nous questionnent et nous amènent à nous redéfinir autrement.
Le groupe s'est retrouvé samedi 9 mars à La Colline pour la représentation de Painkiller de Pauline Haudepin. Après avoir expérimenté par eux-mêmes son processus de création lors de l’atelier d’écriture en novembre, cette soirée a été l’occasion de découvrir son travail de mise en scène.
Une expérience théâtrale qui a nourri la créativité des JR...
Le mot d'Alice
Ce spectacle de Pauline Haudepin mêle rire et absurde. Une existence grise que les personnages refusent et ne comprennent plus. Rejetés. Que faire quand on ne sait plus rire? Enlever et séquestrer un humoriste ? Et s’il est aussi perdu et désabusé que vous? S’enfermer dans une salle de bain? Se recroqueviller, position foetale, dans une baignoire et se raconter des histoires? Peut-être … Aller au théâtre ? Sans doute, car cette pièce de Pauline Haudepin colore nos incompréhensions d’émotions, de rire et des récits de personnages qui nous ressemblent tous un peu.

Le deuxième temps fort du mois de mars a été la représentation de Cavalières d’Isabelle Lafon le 28 mars, suivie d’une rencontre avec les comédiennes centrée sur la méthode de travail d’Isabelle Lafon donnant la part belle à l’improvisation, et des questionnements féconds sur les nouvelles formes de solidarité à inventer.
C’est la pièce sur laquelle tu espères tomber à chaque fois que tu vas au théâtre. Celle qui te fait perdre les mots. C’est la pièce dans laquelle tu te reconnais, qui te rassure et te questionne en même temps. Cavalières donne faim de rencontre.
Le flot de parole, bafouillant, hésitant, semble par instant erratique et sinueux, et est constamment à mi-chemin entre pensée en train d’être formulée, lettre qu’on rédige, ou discours sur le vif [...] Le récit nous happe, nous fait rire, nous fait rêver, toujours en jouant de l’émotion avec délicatesse.
Rêverie sur "Cavalières" par Julia Moulin
Il y a une silhouette qui tente de pousser en avant le corps d'un cheval. Elle n'a pas encore compris qu'elle ne marchera pas avec l'animal mais dans l'animal. Cela ne saurait tarder, il semblerait que la silhouette et l'animal soit voués à la fusion, tout comme l'âme et son corps, comme le désir et son accomplissement. Bien sûr que c'est hésitant : n'est-ce pas ce qui fait tout le charme de la chose ?
Un poème : "Un corbeau dans mon corps s'envole", YU Xiuhua
paradoxalement, il s'élance vers le crépuscule
dans la lumière de plus en plus faible tournoie
les crêtes montagneuses font à nouveau face à l'illusion du temps enseveli
à moins que ces mêmes crêtes n'enfouissent le mirage du temps
ce corps à l'intérieur duquel un corbeau séjournait n'est-il que simulacre ?
les doutes ne peuvent empêcher ce corvidé dans mon corps de prendre son essor
il sait comment voler, il le sait parfaitement
et il veut le faire mieux encore, de sorte que n'y trouvant rien à redire l'angoisse
nous étreint
un oiseau appartient d'abord au ciel, ensuite au champs
enfin à celui qui le regarde dans les airs
le corbeau envolé, qu'adviendra-t-il du corps ?
l'attente sur place est-elle volontaire ?
l'oiseau envolé, nul moyen de récupérer sa noirceur
- ceux qui ne croient pas en la nuit ont un casier judiciaire entaché
le corps ignore le retour du corbeau

Enfin, Garance Loukine et Théo Courtin se sont lancés dans l'art de la critique :
Quatre femmes dans une salle vide, à peine meublée de trois chaises et quelques rais de lumière. Et pourtant l’histoire surgit comme par magie. Cela commence par un jeu presque enfantin : « elle dit que... » et on invente un elle avec son histoire qui se déploie dans les mots. Le flot de parole, bafouillant, hésitant, semble par instant erratique et sinueux, et est constamment à mi-chemin entre pensée en train d’être formulée, lettre qu’on rédige, ou discours sur le vif. On a affaire à une véritable polyphonie à quatre voix, dont le charme repose pour beaucoup sur l’improvisation, la fragilité de la voix qui semble à tout instant pouvoir se briser, et sur le rythme endiablé sur lequel enchaînent les actrices se répondant, s’entre-coupant et s’opposant parfois violemment. Un rapport intime se tisse entre ces femmes, avec au cœur de cette relation Madeleine, petite fille qui n’existe qu’en « hors-champ », via les dits des actrices. Sans qu’on s’en rende compte, le récit nous happe, nous fait rire, nous fait rêver, toujours en jouant de l’émotion avec délicatesse.
Théo Courtin
C’est compliqué de rassembler toutes ses émotions après avoir vu quelque chose qui nous a vraiment touché. Ce que je peux dire c’est que j’ai été profondément émue par l’humour, l'intelligence et la justesse qui traversent cette belle création. Les comédiennes sont magnifiques, leurs singularités de jeu s’accordent si bien pour former un tout et habiter cette histoire de femmes qui se rencontrent en vivant ensemble, en s’occupant de Madeleine. Madeleine qui n’est pas physiquement là mais tellement présente, comme si la salle tout entière la faisait vivre en occupant pleinement la place laissée à nos imaginations à ce qui se reflète en chacun. La présence des chevaux et les mots si justes trouvés pour en parler ont éveillé en moi l’envie de poser ma tête sur le flanc d’un cheval et d’écouter sa respiration de profiter de sa chaleur des petits tremblements qui agitent sa peau... J’ai du mal à dire tout ce que je voudrais dire sur ce beau travail, mais gardons nos singularités et aimons-les !
Garance Loukine
Février : théâtre et gastronomie
Pour ce rendez-vous hivernal, les Jeunes reporters ont assistés à la dernière représentation de Tout le temps du monde de l'autrice, metteuse en scène et comédienne grecque Danai Epithymiadi. Maëlle et Garance livrent ici deux créations graphiques inspirées par la pièce.


Après la représentation, les Jeunes reporters ont participé avec le public à un atelier de cuisine animé par Danai Epithymiadi et le comédien Giannis Karaoulis. Les deux "artistes chefs" ont partagé trois recettes de mezzés grecs, confectionnées avec les spectateurs dans le hall du théâtre tout en faisant le récit de l'histoire artistique et gastronomique de la Grèce. Les mets préparés, tous les participants ont dressé un banquet pour partager ce dîner ensemble, aux sons de musiques grecques. Une expérience de partage culturel et culinaire, documentée en vidéo par les Jeunes reporters.
Si ces images vous ont ouvert l'appétit, rendez-vous sur le compte Instagram des JR pour retrouver les recettes !
Janvier / février 2024 : dans l'enfer de La Plâtrière
Au mois de janvier, à l’occasion de la présentation du spectacle Ils nous ont oubliés de Séverine Chavrier, les Jeunes Reporters se sont immergés dans l’univers de Thomas Bernhard et de son texte La Plâtrière. Ils ont dans un premier temps assisté au vernissage du projet scénographie inter-écoles, dont l’édition 2023 était conçue à partir du texte du spectacle et proposait aux étudiants d’écoles d'art partenaires du théâtre de se lancer dans un processus de création scénographique à travers des ateliers et rencontres avec des professionnels du théâtre. La Jeune reportrice Maëlle Maréchal nous propose un compte-rendu vidéo de cet événement !
Le 23 janvier, ils se sont rendus au Théâtre 14 pour assister à la représentation de Personne de Gwenaëlle Aubry, pièce dans laquelle l'autrice développe un abécédaire poétique pour dresser le portrait de son père disparu. Personne comme l’absence, comme l’identité d’un homme, comme le masque social… Autant d’enjeux qui se rattachent aux thématiques de la peur et de la métamorphose, explorées cette année par les Jeunes Reporters. Ils rencontreront l’autrice en avril pour échanger avec elle.
Quinze jours plus tard, les Jeunes Reporters se sont à nouveau réunis pour assister à Ils nous ont oubliés, un huis clos qui semble les avoir fortement inspirés dans leur production de contenus :
- une chanson par Rozenn, Gabrielle et Ivy
- un micro-trottoir en sortie de salle par Maëlle et Anatole
- des ressentis sur la pièce par Garance, Lydie et Julia :

Décembre 2023 : d'un hiver à l'autre
Pour leur deuxième rendez-vous, les Jeunes Reporters de La Colline ont été conviés au Carré Beaudouin pour assister à la projection du film Winter Sleep (Kış Uykusu, 2013) du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan. Palme d'Or au Festival de Cannes 2014, le film plonge les spectateurs au cœur de l'hiver en Anatolie Centrale et suit les déboires d'un couple dont les sentiments s'étiolent. Accompagnés par Fanny Burdino, Docteure en cinéma et scénariste, les Jeunes Reporters se sont ensuite livrés à une analyse du film et ont tout particulièrement creusé la thématique du ressentiment.
D'un hiver à l'autre, nos « JR » ont ensuite pu assister à une représentation de Neige, le conte initiatique et féérique de Pauline Bureau. Trois d'entre eux ont rédigé des critiques sur la pièce, dont voici quelques extraits :
- « Neige est une héroïne de conte de fée qui donne à la féminité une force auto-constitutive. Le Prince fantasmé de Neige est balayé loin, hors du décor. » Lou Bitan
- « Sortir du miroir, laisser de côté le ressentiment qui fige et condamne à une unique image répétée inlassablement. Sortir et, comme la mère de Neige, re-sentir pour ressentir à nouveau. » Alice Le Dantec
- « Neige de Pauline Bureau est une habile réécriture du conte de Blanche-Neige. Cette histoire touchante est sublimée par une mise en scène originale. »Lucas Croset
Certains, comme Maëlle, ont préféré utiliser le dessin et la vidéo pour exprimer leur avis :
 |
Enfin, saluons Ivy, Rozenn, Gabrielle et Leïla qui, à l'image des comédiens de « Neige », n'ont pas hésité à mouiller le maillot !
Des mots. Des échos. Un flot incessant d’impressions, de sensations, d’émotions. Les regards se sont rencontrés, les sourires se sont répondus. C’est comme ça qu’est né ce projet. C’est à peine sorties de la salle que nous nous sommes emparées de nos carnets pour gratter sur le papier. Cinq jours plus tard, c’est dans un studio d’enregistrement que les mots ont surgi, bien réels. Le lendemain, nous étions dans une piscine, armées d’une caméra et de bonnets de bains peu flatteurs.
Nous désirions refléter tout ce que le spectacle de Pauline Bureau nous évoquait. Combien il nous rappelait notre propre enfance. Cette vidéo nous fait revivre des étés joyeux passés au bord d’une piscine et entre à la fois en résonance avec les séquences filmées présentées dans « Neige ».
Rendez-vous en janvier pour la suite de leur parcours théâtral à La Colline.
Novembre 2023 : Première rencontre
L'aventure de la promotion 2023-2024 des Jeunes Reporters de La Colline a débuté le 11 novembre dernier, à l'occasion d'un atelier d'écriture s’inscrivant dans la première thématique de l’année : la peur et le ressentiment.


photos © La Colline
Se rencontrer par l’écriture
Quarante Jeunes Reporters se sont donc rencontrés en compagnie de Pauline Haudepin, autrice, metteuse en scène et comédienne, chargée d’animer l’atelier d’écriture. Par petits groupes de deux ou trois, ils et elles ont pu, à partir de photographies de Gregory Crewdson (photographe américain qui travaille sur l’envers du rêve américain à travers ses photos de foyers et quartiers) choisies par Pauline Haudepin, écrire ce que l’image leur inspirait, dans un premier temps sous forme de liste de mots.
Leur attention s'est ensuite portée sur un détail, en vue d’élargir petit à petit le regard : décider de son temps, son espace, sa date. Choisir un de ses personnages, une de ses figures, y mêler un souvenir intime. Faire avec l’autre à partir de soi. Figer son nom et prénom, décider de son âge, lui attribuer un désir, sans oublier une peur qui la traverse.
Les « JR » ont ensuite été amenés à questionner cette figure puis laisser leurs camarades décider des réponses. Un travail en commun qui amène un échange, un dialogue, avant d'imaginer les didascalies de la scène et d'y faire naître le monologue intérieur du personnage, qu'ils ont ensuite pu lire à haute voix... et chanter même, parfois.
Ecrire en éprouvant le temps
Pendant toute la durée de cet atelier, l’écoute active de Pauline Haudepin et du groupe a offert aux Jeunes Reporters un espace de liberté pour se raconter et déployer leurs imaginaires. En trois heures, l’histoire d’un instant figé et photographié prend vie. L’image devient mouvement, les corps empreints d’une trajectoire.
Amorcer les thématiques de la peur et du ressentiment via l’énergie du collectif, ne serait-ce pas déjà lutter contre ces dernières ?


photos © La Colline
Prochain rendez-vous
Les Jeunes Reporters se retrouveront le 2 décembre prochain autour de la projection d’un film et d'une discussion avec la docteure en cinéma et scénariste Fanny Burdino. Ils assisteront ensuite à la représentation de Neige de Pauline Bureau et proposeront quelques jours après leurs premiers « articles » de Jeunes Reporters que vous pourrez lire, regarder ou écouter sur le site de La Colline.
Pour découvrir les thématiques, les spectacles et les ateliers proposés aux Jeunes reporters cette année, consultez le programme complet :